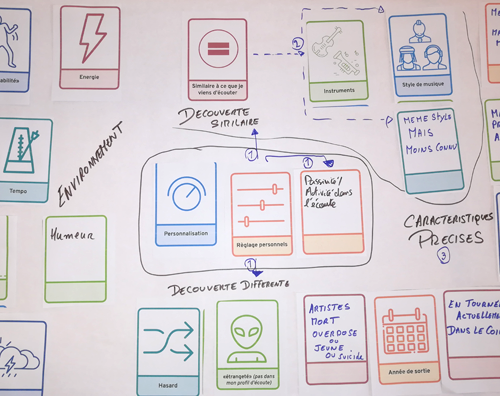Le 16 octobre dernier, La Péniche co-organisait avec l’ADRETS une journée d’échange et de travail autour des enjeux liés aux données pour les territoires ruraux, notamment en termes de développement local et de services. Retour sur la table-ronde de la matinée, qui réunissait des acteurs nationaux et territoriaux afin d’échanger autour de ce sujet.
Si on parle beaucoup de données dans le contexte urbain des métropoles et « smart cites», les données ne constituent plus une perspective lointaine pour les territoires ruraux, mais une réalité qui a pris place dans la plupart des métiers ; ceux liés au développement territorial ou aux services aux publics n’y échappent pas.
Mais les territoires ruraux ne sont souvent pas très avancés, comme le témoigne Laetitia Pras de la Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras, leurs moyens étant restreints, les compétences et missions souvent partagées entre plusieurs agents et les priorités premières en termes de numériques sont souvent liées à la connexion ; l’intérêt pour le sujet vient plutôt des obligations réglementaires , que ce soit les lois autour de l’open data ou le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles). La compréhension des enjeux du sujet peut aussi venir de l’appétence des agents comme c’est le cas dans cette Communauté de Communes.
Ouvrir les données, quels enjeux ?
Les intervenants se rejoignent sur au moins un point : l’approche des données pour les données n’aide pas vraiment pour les territoires quels qu’ils soient, et moins encore pour les territoires ruraux. Et Charles Népote de rappeler que d’un discours « Ouvrez vos données et on verra » des débuts de l’open data, qui a souvent ouvert la porte à des données de mauvaise qualité ou/et peu réutilisées, la situation évolue un peu vers des réflexions sur les besoins en termes de données et leurs usages… de plus en plus vers un open data (aussi) tiré par la demande.
Si l’injonction réglementaire à l’open data est bien là pour toutes les collectivités au-delà de 3500 habitants et que l’association Open Data France travaille à accompagner ces évolutions, sa présidente, Laurence Comparat, partage la nécessité du sens de ces démarches ; il s’agit de construire un patrimoine, un bien commun, mais aussi de réfléchir aux enjeux en termes d’animation du territoire : comment faire naître de nouveaux modes de mobilité, de façons de trier les déchets, etc. N’ouvrir que parce que la loi l’impose, à la va-vite, est une des meilleures façon de mal ouvrir les données : cela doit être l’occasion de transformer ses pratiques autour de la production des données, leur circulation, leurs usages, de changer d’outils, de progresser dans le partage des données interne ou externe… en somme, cela ne doit pas être qu’un projet technique, mais organisationnel.
Rémy Seillier, de la cellule Innovation du CGET, va dans le même sens ; ouvrir seulement les données ne suffit pas pour en saisir les opportunités. Il s’agit d’aborder les données dans le cadre d’une logique de projets, en mettant autour de la table différents acteurs (acteurs, publics, privés, associatifs…), dans des logiques de coopération.
Mette en œuvre des stratégies d’ouverture des données ou développer une culture de la donnée : cela peut sembler complexe pour de petits territoires ruraux. Mais la donnée n’est pas totalement nouvelle pour autant pour ces acteurs, qui manipulent déjà des données – numériques ou non – au quotidien, en témoigne le décompte des voix dans les petits bureaux de vote, qui produit de la donnée. Le terme de « données » peut faire peur, d’où la nécessité de rassurer, notamment les élus, témoigne Laetitia Pras.
Manipuler de la donnée et en faire quelque chose peut être relativement accessible une fois la dynamique lancée et les enjeux identifiés, selon Charles Népote ; ainsi à Orange, les agents pérennisent un travail de mise à jour des données initié par un agent, Jean-Louis Zimmerman, qui a collecté énormément de données sur OpenStreetMap. D’autres territoires s’emparent d’OSM pour éditer des plans de villes, une fois les données publiques injectées dans OSM.
Que faire avec des données ?
Tout ne sera pas accessible rapidement ; en effet, si certains des participants se prennent à rêver que demain, le rôle de tout acteur public territorial puisse être d’intégrer des données issues de différents acteurs publics ou privés d’un territoire (par exemple, tous les opérateurs de transport publics ou privés, afin d’offrir une information complète aux citoyens), Laurence Comparat confirme que le multi-source de données aujourd’hui est compliqué, même pour les métropoles.
Mais sans aller aussi loin, la co-construction à partir de données peut concerner des collectivités de toutes taille : par exemple, en ouvrant aux associations d’un territoire la possibilité d’ajouter leurs évènements sur l’agenda local, comme cela est fait dans le cadre du Schéma de services de la Maurienne. La logique de coproduction de services marche aussi à une petite échelle, témoigne Guillaume Doukhan d’Adrets.
En ayant une culture de la donnée « de base », les agents des petites collectivités peuvent déjà faire un certain nombre de choses par eux-mêmes, comme aller chercher des données ouvertes sur data.gouv.fr concernant leurs communes (9 jeux de données, notamment de l’INSEE, peuvent ainsi être téléchargés pour toute commune). Cela prend néanmoins du temps d’installer ces pratiques, ce qui peut être un problème dans des collectivités qui connaissent beaucoup de turn-over sur les mêmes postes.
Comment progresser ?
Les acteurs locaux peuvent manquer d’outils ou de référentiels leur permettant de mobiliser et d’ouvrir les données ; ainsi, la mutualisation de données peut être complexe en termes de standards… à quel échelon mutualiser, et sur quels standards s’aligner ? Le socle commun des données locales, issu d’un travail d’Open Data France, peut être utile pour construire un référentiel commun, et générer un effet de masse.
Autre piste intéressante pour les petits territoires, les outils mutualisés : lors de la conception de la plateforme du Carrefour des innovations sociales, co-portée par le CGET, le choix a été fait de concevoir 3 briques open source ; une permettant de scrapper des données, une autre visant à les agréger, une autre enfin à les visualiser. Des briques pourraient demain être un exemple d’outils partagés, dont de petits acteurs n’ayant pas beaucoup de moyens pourraient s’emparer pour manipuler des données.
Les enjeux d’acculturation sont essentiels, en conviennent les intervenants. Sur ce sujet data et open data, le CNFPT devrait aller beaucoup plus loin, proposer davantage de formations ; les associations d’élus (ex. Association des Maires de France) devraient être davantage interpellés, afin de partager les expériences, de sensibiliser ou former les élus autant que les techniciens, quels que soient leur métier, point sur lequel convergent les intervenants.
Comme pour les enjeux d’accessibilité au numérique et aux services numériques, il y a des besoins de médiation, d’accompagnement, qui pourraient demain prendre place dans les MSAP, ou dans des tiers lieux ; couvrir le territoire, y compris avec des services de médiation qui se déplacent, pourra être une piste intéressante pour le développement territorial et l’accessibilité des services.
Si elle a permis de traiter de sujets encore peu abordés et sur lesquels il est encore assez difficile de trouver des exemples – souvent peu médiatisés – cette table-ronde a aussi permis de lancer la journée de travail autour des opportunités que représentent les données pour améliorer l’accès aux services en territoires ruraux… à suivre, la publication d’un petit livret capitalisant sur les échanges de cette journée et sur quelques mois de travaux autour du sujet !